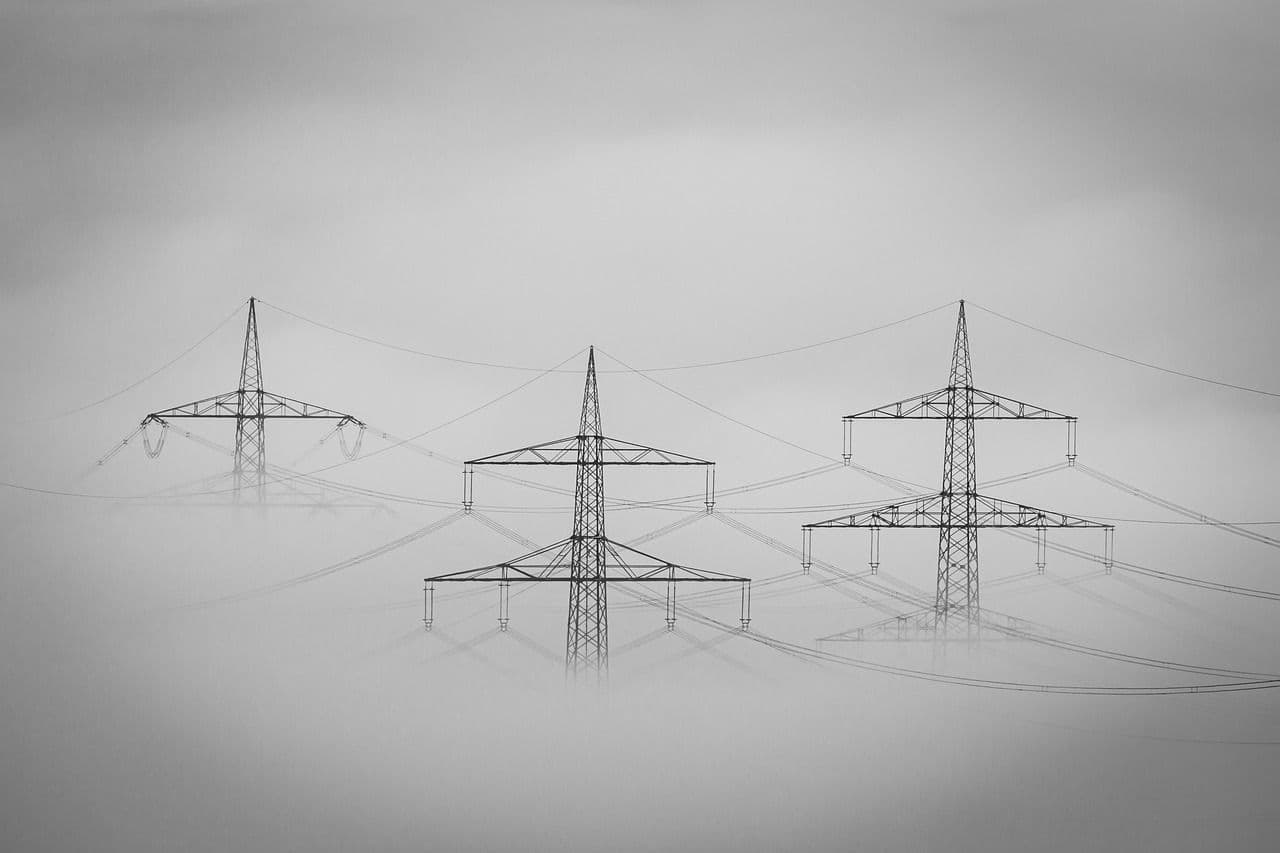Le vrai du faux sur la chaleur et la décarbonation
Lorsqu’on parle d’énergie et de climat, on est confronté à un florilège d’idées reçues qui suscitent souvent des réponses contradictoires. Avec cette FAQ centrée sur l'énergie Carbone 4 cherche à éclairer le débat pour démêler le vrai du faux en proposant une approche scientifique et chiffrée pour chaque idée reçue.
Pour tout savoir sur l'énergie et le climat, découvrez les autres FAQ disponibles
L’électricité est-elle l’énergie la plus consommée en France ?
Quand un débat est lancé sur l’énergie en France, la discussion tourne souvent autour de l’électricité. Penser que l’électricité est le cœur du sujet provient d’une place prédominante du nucléaire dans le débat français ainsi que de la représentation quotidienne de nombreux usages électriques comme l’éclairage, les appareils électroménagers et informatiques.
En réalité, l’électricité correspond à 25% de la consommation énergétique française. Elle permet de servir les usages précités mais aussi le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, la cuisson, etc.
25%, c’est significatif mais nos déplacements par exemple, qui reposent quasi exclusivement sur le pétrole, représentent 30% de notre consommation énergétique.
Plus élevés encore sont nos besoins en chaleur. Ils représentent 45% de la consommation énergétique française. Certes, une partie est couverte par de l’électricité mais le gaz naturel et le fioul sont encore très présents.
La production de cette chaleur représente 2/3 des besoins énergétiques des bâtiments résidentiels et tertiaires (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson) et la moitié des besoins énergétiques des industries (cuisson, séchage, fonte des métaux, etc.).
Avec le réchauffement climatique, il n’y aura bientôt plus besoin de se chauffer en hiver ?
Le réchauffement climatique induit une augmentation moyenne des températures mondiales. C’est le cas tout au long de l’année mais des hivers plus doux génèrent paradoxalement une boucle de rétroaction “positive”[1] pour le climat. En effet, s’il fait moins froid, il y a moins besoin de chauffer les bâtiments. En conséquence, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre associées diminuent.
Pour mesurer à quel point il a fallu plus ou moins se chauffer sur une année, on utilise le nombre de degrés-jours de chauffage. Si la température moyenne d’une journée est supérieure ou égale à 15°C, le nombre de degrés-jours sur la journée est nul. Dans le cas contraire, il est égal à la différence entre 15°C et la température moyenne de la journée.
Vers 1980, il y avait environ 2900 degrés-jours de chauffage alors qu’aujourd’hui, le chiffre avoisine les 2000. Cette diminution annuelle de -1%/an des besoins de chauffage est amenée à se renforcer dans les décennies à venir. Vers 2050, il est probable qu’en France, on se rapproche fortement des 1500 degrés-jours de chauffage. A cet horizon de temps (celui d’un appareil de chauffage), on se chauffera moins mais on se chauffera bien encore.
Un petit mot sur le besoin inverse : se refroidir en été quand il fait très chaud. Cette fois-ci, la boucle de rétroaction[2] est “négative” pour le climat. Plus il fait chaud, plus il y a de gaz à effet serre générés par l’utilisation de la climatisation.On utilise une unité similaire, les degrés-jours de refroidissement, qui mesurent l’écart entre 24°C et la température moyenne des journées très chaudes.
Même si le besoin de refroidir a fortement augmenté pour atteindre 100 degrés-jours de refroidissement récemment, il n’y aura “que” quelques centaines de degrés-jours en 2050. Si tout le monde avait un système de climatisation (ce qui n’est pas le cas contrairement au chauffage), alors le besoin énergétique serait grosso modo 10 fois inférieur à celui actuel pour le chauffage.
Cela étant, concernant la consommation énergétique, cette prédominance du chauffage n’est pas valable dans tous les pays. Aussi, l’impact sanitaire des fortes chaleurs est bien plus élevé que celui des vagues de froid. Tout l’enjeu devient alors l’adaptation des bâtiments. L’isolation avec des matériaux biosourcés permet un confort thermique estival sans commune mesure avec celui des matériaux minéraux ou fossiles.
Privilégier les systèmes passifs d’ombrage, et les habitudes d’aération aux heures les plus fraîches de la journée permettent d’éviter les climatiseurs. Ces derniers posent problème en rejetant l’air chaud à l’extérieur, notamment en ville où ils renforcent l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Les besoins en chaleur sont-ils surtout de la haute température ?
Les niveaux de température peuvent être classés en 3 catégories :
Basse température : inférieur à 100°C
Moyenne température : entre 100°C et 400°C
Haute température : supérieure à 400°C
Les bâtiments étant les plus gros consommateurs de chaleur, c’est la basse température qui prédomine. Elle correspond à 75% des besoins.
Pourtant, pour produire cette basse température, les combustibles fossiles et le bois sont utilisés en grande majorité (75%). Or, dans un contexte de décarbonation, les énergies fossiles sont vouées à disparaître. Le bois, lui, est une ressource rare. Il doit donc être utilisé avec parcimonie et pour des usages haute température qui n’ont pas d’alternatives décarbonées.
Pour répondre à ces besoins en chaleur basse température, il existe des filières d’énergies renouvelables thermiques économiquement compétitives et contribuant à l’emploi local : pompes à chaleur, solaire thermique et géothermie.
Toutes les chaleurs se valent-elles ?
La chaleur basse température perdue sous forme diffuse est la forme la moins noble de l’énergie, le débouché ultime et peu utile à laquelle est vouée toute énergie in fine (dissipation thermique dans un câble électrique, dans des freins de voiture, dans une ampoule, etc.). À l’inverse, la chaleur haute température a bien plus de valorisations possibles.
Or, tous les types de chaleur ne permettent pas d’atteindre les mêmes plages de température. Ainsi, la combustion, notamment de ressources fossiles, peut produire de la chaleur haute température (bien qu’elle soit largement utilisée pour des usages basse température), là où des pompes à chaleur air/air ne permettent de fournir que de la chaleur basse température. En outre, chaque moyen de production de chaleur présente des potentiels limités, notamment pour des raisons de gisement physique (ensoleillement, renouvellement de la biomasse, disponibilité des surfaces, etc.).
Il est ainsi indispensable de flécher les différents moyens de production avec les divers usages en fonction des niveaux de température. Autrement dit, pour la chaleur basse température, exploiter au plus les moyens de production bas-carbone sans combustion et pour la chaleur haute température, réserver les moyens de production bas-carbone avec combustion.
Les panneaux solaires, c’est rempli de terres rares et ça vient de Chine ?
Les panneaux solaires convertissent l’énergie du rayonnement solaire en une autre forme d’énergie afin de répondre à différents usages. On distingue deux types de panneaux solaires : les panneaux solaires photovoltaïques, qui produisent de l’électricité, et les panneaux solaires thermiques qui produisent de la chaleur.
C’est le premier type de panneau qui est accusé de contenir des terres rares, un groupe d’éléments métalliques qui possèdent des propriétés voisines. Contrairement à ce que leur nom suggère, les terres rares ne sont pas “rares” au sein de la surface terrestre. En revanche, la Chine possède le quasi-monopole de leur production, faisant peser des risques de dépendance.
En réalité, “les technologies solaires photovoltaïques actuellement commercialisées n’utilisent pas de terres rares[3]” mais leur fabrication nécessite des minerais critiques comme le cuivre ou le silicium “métal”[4]. Et surtout, 89% des panneaux photovoltaïques installés en Europe proviennent de Chine
À titre de comparaison, le panneau solaire thermique s’en tire bien mieux. Pas de matériaux critiques et la quasi-totalité des panneaux sont fabriqués au sein de l’Union européenne mais il ne permet pas de répondre aux mêmes usages finaux (chaleur plutôt qu’électricité).
Les panneaux solaires thermiques, ça ne fonctionne bien que dans le sud de l’Europe ?
L’énergie solaire, souvent associée à la production d’électricité, est aussi une source de production de chaleur. L’énergie solaire thermique peut en effet être utilisée par les particuliers comme les industriels pour couvrir une part relativement importante de leurs besoins en chaleur, que ce soit pour la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage de bâtiments ou la fourniture de chaleur basse température pour certains procédés industriels.
Historiquement, les panneaux solaires thermiques ont été installés dans des régions chaudes et très ensoleillées, comme la Californie dès le début du XXème siècle, ou en France dans le sud de la métropole et les outre-mer avec de nombreux chauffe-eaux solaires, simples et peu coûteux.
Désormais, ces systèmes sont devenus considérablement plus efficaces pour être productifs jusque dans les régions les plus septentrionales. Ils ne peuvent souvent pas couvrir 100% des besoins et s'utilisent donc en combinaison avec une autre énergie, et/ou avec une solution de stockage de chaleur.
En Europe, le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche affichent une production par habitant d’énergie solaire thermique largement supérieure à celle de pays plus ensoleillés comme la France ou l’Italie. L’une des plus grandes centrales solaires thermiques au monde est située au Danemark. Elle est en opération depuis 2016 et couvre plus de 20% de la demande des 22 000 foyers connectés au réseau de chaleur[5]. En Haute-Autriche, le solaire thermique est soutenu à l’échelle de la province et compte 0,7 m2 de collecteurs par habitant (10 fois plus que la moyenne européenne). A noter que dans ce dernier cas, la surface des toitures étant limitée, il faut organiser la cohabitation des filières solaires thermiques et photovoltaïques pour maximiser la décarbonation tout en minimisant les ressources utilisées.
En France, le déploiement du solaire thermique accuse un retard par rapport aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2018-2023, qui prévoyait une augmentation de la production de cette filière a minima de 50%.[6] Dans un contexte récent de volatilité des prix du gaz et de l’électricité, le solaire thermique est plus que jamais une solution d’avenir.
La chaleur, ça ne se stocke pas ?
La chaleur ne se transporte pas bien sur de longues distances (> 10 km) et doit donc être produite à proximité du lieu de consommation. Tout comme pour l’électricité, il faut faire coïncider les moments de production avec les moments de demande. Ce défi est d’autant plus important qu’on utilise des moyens de production peu pilotables. Par exemple, la production de solaire thermique culmine en milieu de journée, et est plus importante en été qu’en hiver. A l’opposé, les besoins en chaleur pour les bâtiments sont plus élevés en hiver, le matin ou le soir et pour l’industrie, ils sont souvent constants.
Pour répondre à cet enjeu d’équilibrage, il est possible d’utiliser à la fois des moyens de production variable et pilotable mais aussi des systèmes de stockage.
Comme pour l’électricité, il existe des technologies de stockage de la chaleur à différentes échelle de temps :
- Au pas journalier, comme les ballons d’eau chaude qui ne chauffent pas nécessairement au moment où ils sont sollicités.
- Au pas hebdomadaire, pour répondre à des variations de la consommation entre le week-end et la semaine par exemple.
- Au pas inter-saisonnier, pour conserver la chaleur produite en abondance en été pour son utilisation en hiver.
La technologie la plus répandue et mature est le stockage sensible, basé sur l’inertie d’un matériau chauffé et isolé (ex : de l’eau stockée dans un réservoir ou une fosse creusée dans le sol). Ce matériau peut ensuite restituer la chaleur lorsqu’elle a besoin d’être utilisée. On peut stocker de l’été vers l’hiver quelques dizaines de GWh thermiques avec une déperdition de l’ordre de 25%.[7]
D’autres modes de stockage plus denses sont à l’étude comme le stockage latent (basé sur l’énergie absorbée lors d’un changement d’état par un matériau qui peut être restituée lors du retour à l’état initial ou encore le stockage thermochimique dans lequel la chaleur permet une réaction physico-chimique réversible).
La géothermie est adaptée que pour Île de France et l'Alsace ?
La géothermie regroupe 2 grands types de technologies : la géothermie profonde (qui récupère la chaleur du sous-sol entre 200 et 2500 mètres de profondeur), et la géothermie de surface qui exploite la stabilité de la température dans le sol à faible profondeur (<200 mètres).
En ce qui concerne la géothermie profonde, la France bénéficie de grands bassins aux potentiels importants, notamment les bassins parisien et aquitain. De façon plus singulière (avec des températures plus élevées moins profondément), les fossés d’effondrement (situés dans les bassins rhénan, bressan, rhodanien et dans la Limagne) ainsi que les zones volcaniques (en Guadeloupe par exemple) constituent également des zones d’intérêt[8]. Les ouvrages en exploitation alimentent généralement les réseaux de chaleur urbains mais pour que de telles installations se développent, il est nécessaire qu’une demande suffisamment importante existe. C’est justement le cas en Île de France (qui concentre plus de 80% de la chaleur française issue de géothermie dans ses réseaux de chaleur)[9]. Des projets pourraient être davantage développés ailleurs vu l’étendue des zones potentiellement exploitables.
La géothermie de surface (utilisée pour les pompes à chaleur chez des particuliers par exemple) peut être exploitée sur plus de 90% du territoire car elle ne requiert pas la présence d’une nappe en sous-sol. Elle exploite la chaleur naturellement présente dans le sol. Son déploiement dépend davantage de facteurs économiques (financements et subventions pour réduire le coût élevé de l’investissement) que de facteurs géographiques ou techniques. La disparité de déploiement est très marquée d’une région à l’autre : par exemple, la Bretagne et le Pays de la Loire comptent plus de 50% des installations de géothermie de surface françaises (plus de 4000 installations)[10]. La géothermie de surface a un potentiel important. Elle ne représente qu’environ 5 TWh de production annuelle de chaleur aujourd’hui en France, mais pourrait produire 100 TWh .[11]
Les pompes à chaleur ça ne marche plus dès qu’il fait froid ?
Soutenue par l’État français pour la production de plus de 1 millions d’unités prévues dès 2027,[12] la pompe à chaleur (PAC) est plébiscitée pour décarboner la chaleur domestique et réindustrialiser la France. Malgré une croissance initialement en ligne avec les recommandations de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2018-2023,[13] les ventes de PAC accusent un léger ralentissement entre 2022 et 2023 (+4,6%)[14]. En cause, un contexte inflationniste, un prix du gaz en baisse sur les marchés de gros et des aides moins lisibles.[15]
La PAC a pour avantage de produire plus d’énergie qu’elle ne consomme d’électricité, en prélevant les calories “gratuites” dans son environnement direct : l’air extérieur pour les PAC aérothermiques, une source d’eau pour les PAC hydrothermiques et le sol via un forage pour les PAC géothermiques. Elles restituent ensuite la chaleur via de l’air soufflé (climatiseur réversible) ou des canalisations d’eau (radiateurs à eau, plancher chauffant).
Cependant, lorsque les températures baissent, les PAC sont moins efficaces. La performance des PAC est mesurée par le coefficient de performance (COP) correspondant au ratio de l’énergie thermique utile sur l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’appareil. En condition de température standard, le COP de la pompe à chaleur est donc supérieur à 1 (elle produit plus d’énergie qu’elle ne consomme d’électricité). À titre de comparaison, le radiateur électrique a toujours un COP au mieux égal à 1 puisqu’il transforme l’énergie électrique en énergie thermique avec un rendement maximum de 100%.
Le COP est intrinsèquement lié à la différence de température entre la source froide (dans laquelle elle puise les calories) et la source chaude (à laquelle elle restitue la chaleur). Il est inversement proportionnel à l’écart des températures de la chaleur fournie par la PAC et de l’énergie prise dans l’environnement. Lorsqu’il fait froid dehors, la température de consigne étant inchangée, l’écart se creuse et la performance d’une PAC aérothermique diminue. A noter que cet effet est très faible quand la source froide est le sol car sa température avoisine les 13°C tout au long de l’année.
La température limite extérieure se situe souvent à -7°C, garantissant un fonctionnement normal toute l’année sur la majorité du territoire français. Certaines PAC spécialisées fonctionnent même jusqu’à -15/-20°C.[16]
Contactez-nous
Pour toute question sur Carbone 4, ou pour une demande concernant un accompagnement particulier, contactez-nous.